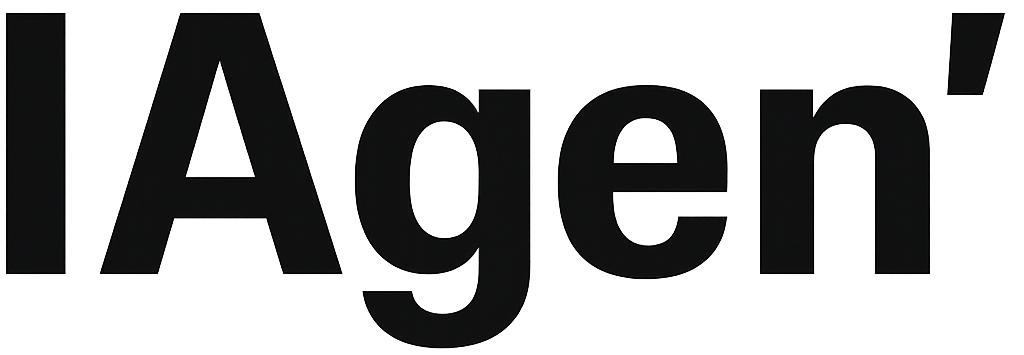En 2025, l’intelligence artificielle cesse d’être une promesse lointaine pour devenir un levier concret de performance. Publicis en fournit un exemple frappant : le groupe affiche une croissance organique nette de 5,7 % au troisième trimestre, en grande partie grâce à ses services basés sur l’IA. Comme le souligne Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe : « Pour Publicis, l’intelligence artificielle n’est pas une promesse d’avenir, c’est déjà un moteur de croissance. Nous continuons à gagner des parts de marché et à nous affirmer comme une « Category of One », grâce à notre modèle unique, optimisé par l’IA. » Ce succès illustre que l’IA, loin d’être un simple projet technologique, doit être orchestrée et alignée sur la stratégie globale pour générer de la valeur tangible. Les entreprises qui sauront transformer les expérimentations isolées en systèmes durables auront un avantage compétitif déterminant. Car si beaucoup “font de l’IA”, peu peuvent réellement dire qu’elles l’ont comprise, orchestrée et intégrée. Les pilotes se multiplient, les expérimentations fleurissent, mais rares sont les organisations capables de transformer cette effervescence en système durable.
L’IA comme table de dialogue : une métaphore de la transformation collective
C’est dans ce décalage entre frénésie technologique et lenteur organisationnelle qu’émerge une image forte : celle d’une table de l’IA, partiellement dressée. Certaines chaises sont déjà occupées : celles des directions data, de la DSI, des équipes innovation ou des métiers pionniers. D’autres, en revanche, demeurent vides : les ressources humaines, la conformité, la communication, parfois même la direction générale. Pourtant, sans elles, la table reste bancale. Cette image n’est pas un simple artifice : elle illustre la réalité d’un moment charnière où les entreprises doivent passer d’une approche fragmentée de l’intelligence artificielle à une vision collective et cohérente.
Pendant plusieurs années, l’IA a été abordée comme un sujet “à côté” , un projet technique, souvent confié à des experts isolés ou à des partenaires externes. Cette phase d’acculturation a eu son utilité : elle a permis d’expérimenter, de tester, d’évangéliser. Mais elle a aussi enfermé la technologie dans une forme d’entre-soi. Or, l’intelligence artificielle n’est pas une discipline : c’est une langue commune que tous les acteurs de l’entreprise doivent apprendre à parler. Elle ne transforme pas seulement les outils, mais les relations de travail, les modes de décision, la manière de créer et de mesurer la valeur.
Autrement dit, l’enjeu de 2025 n’est plus de “lancer des projets IA” : il est de savoir s’asseoir autour de la même table. L’IA devient un espace de dialogue entre les directions métiers, la DSI, la data, les RH et la stratégie. Une entreprise qui avance seule, sans cette mise en concert, se condamne à l’inefficacité : ses cas d’usage se fragmentent, les indicateurs se contredisent, les initiatives se concurrencent. La table de l’IA, au contraire, impose une discipline nouvelle : celle de la transversalité.
Car au fond, l’intelligence artificielle agit comme un miroir organisationnel. Elle révèle la capacité – ou l’incapacité – des entreprises à penser ensemble. Lorsqu’un modèle d’IA est développé sans ancrage métier, il reste une prouesse technique sans adoption. Lorsqu’il est porté par un métier sans alignement IT, il devient une dette technologique à venir. Lorsqu’il avance sans gouvernance éthique ou RH, il crée des tensions culturelles et sociales profondes. Chaque chaise vide à la table de l’IA n’est pas un oubli : c’est un risque.
Dans les entreprises les plus matures, cette table existe déjà. Elle ne se limite pas à un comité de pilotage formel ; c’est un lieu de délibération stratégique. On y retrouve les data leaders, garants de la fiabilité et de l’éthique technologique ; les responsables métiers, qui traduisent les opportunités en valeur concrète ; les RH, qui anticipent les compétences à développer et les transformations culturelles ; les directions générales, enfin, qui fixent le cap et arbitrent les priorités. Autour de cette table, chacun détient une pièce du puzzle, mais c’est l’orchestration des voix qui donne sa cohérence à l’ensemble.
Cette table de l’IA devient ainsi une infrastructure de gouvernance. Là où hier les réunions séparaient business et technique, elle les réunit dans un même espace de décision. Là où les fonctions s’opposaient sur la légitimité ou la temporalité des projets, elle crée un lieu de dialogue et de compromis. En somme, l’intelligence artificielle n’est pas qu’un moteur d’efficacité : elle est un test de maturité collective.
Car les organisations qui réussiront demain ne seront pas celles qui auront le modèle le plus performant, mais celles qui auront su faire dialoguer toutes les intelligences humaines et artificielles autour de cette table commune. Celles qui auront compris que l’IA n’est pas seulement une question de technologie, mais de gouvernance, de culture et de vision partagée.

Les défis de la table : quand la coordination devient le cœur du problème
S’asseoir autour de la table est une chose. S’y comprendre en est une autre.
Car dans la plupart des organisations, cette table de l’IA, censée rassembler, révèle avant tout les fractures internes : silos de données, priorités contradictoires, visions fragmentées. Chacun arrive avec son langage, ses attentes, ses urgences. Les métiers parlent impact opérationnel, la DSI évoque dette technique, la data prône qualité et gouvernance, les RH s’inquiètent des compétences. Autant de rationalités légitimes mais souvent dissonantes. Le premier défi de la table de l’IA, c’est donc l’orchestration : comment transformer un assemblage de voix hétérogènes en une intelligence collective cohérente.
Cette difficulté de coordination n’est pas nouvelle, mais l’IA l’exacerbe.
En effet, l’intelligence artificielle est par nature transversale : elle touche à la fois aux outils, aux processus, aux décisions et à la culture. Elle ne se loge dans aucun service, elle les traverse tous. C’est ce qui fait sa puissance et sa complexité. Là où un projet ERP ou CRM restait cantonné à une direction donnée, un projet IA interroge simultanément la stratégie, la donnée, les méthodes de travail et la conduite du changement. Sans un cadre clair, sans un espace de délibération partagé, cette transversalité devient une source d’entropie.
Les organisations le découvrent souvent à leurs dépens.
Lorsqu’aucune gouvernance n’est définie, les initiatives prolifèrent : un chatbot ici, un outil d’automatisation là, un moteur de recommandation ailleurs. Chacun agit de bonne foi, mais sans alignement global.
Le résultat ? Des projets qui se chevauchent, des investissements redondants, des jeux d’acteurs mal coordonnés. Le tout dans un brouillard stratégique où les gains promis peinent à se concrétiser. Ce que l’on appelle souvent “le chaos des POC” n’est pas un problème technique : c’est le symptôme d’une table incomplète, d’une conversation qui n’a jamais vraiment eu lieu.
À cela s’ajoute un autre défi, plus subtil : la temporalité.
L’IA avance vite, trop vite pour les cycles décisionnels traditionnels. Entre les annonces médiatiques, les promesses des fournisseurs et les attentes internes, les directions sont soumises à une pression inédite : “il faut faire de l’IA”. Mais l’urgence, si elle n’est pas cadrée, devient contre-productive. Elle pousse à la réaction, à la démonstration, au “quick win” à tout prix — souvent au détriment de la cohérence d’ensemble. Une table où chacun veut parler le premier, sans avoir écouté l’autre, finit en cacophonie.
Et puis, il y a les chaises vides.
Dans bien des cas, certaines fonctions clés sont absentes des discussions : les RH par exemple, alors qu’elles sont au cœur du sujet car l’IA redéfinit les compétences, les métiers et la formation. Le juridique et la conformité, trop souvent convoqués en aval, alors qu’ils devraient contribuer dès la conception. Ou encore la communication interne, dont le rôle est décisif pour transformer la perception des salariés. Une table sans ces voix-là n’est pas seulement incomplète : elle devient aveugle sur ses propres angles morts.
Ce défaut de coordination produit un paradoxe cruel : plus l’IA progresse dans les outils, plus elle révèle les immaturités humaines dans la gouvernance. Là où la machine apprend à raisonner par itération, l’organisation peine à raisonner collectivement. Elle multiplie les métriques sans parvenir à définir un sens commun de la performance. Elle investit dans les modèles sans dialogue préalable. Et c’est là que se joue la vraie fracture : non pas entre ceux qui ont l’IA et ceux qui ne l’ont pas, mais entre ceux qui savent en parler ensemble et ceux qui ne savent pas l’orchestrer.
Au fond, la table de l’IA n’est pas une métaphore de convivialité, c’est une métaphore de maturité. Elle force les organisations à apprendre un art oublié : celui de la conversation stratégique, où chaque fonction écoute avant d’agir, où la donnée devient un langage commun, et où la gouvernance se construit non pas autour du contrôle, mais autour du sens.
Ce que permet une table bien structurée : gouverner, aligner, transformer

Lorsqu’elle est complète et vivante, la table de l’IA cesse d’être un symbole : elle devient un véritable organe de transformation. Non plus un lieu de discours, mais un espace de décision, où la stratégie prend corps dans des choix concrets, mesurables, alignés. C’est là que l’intelligence artificielle, au lieu d’ajouter une couche d’innovation supplémentaire, devient le moteur d’une refonte collective.
Une table bien structurée, d’abord, rétablit le lien entre vision et exécution.
Trop souvent, les entreprises oscillent entre deux écueils : une vision trop théorique, déconnectée du terrain, ou une multiplication d’expérimentations sans cap global. En réunissant autour d’un même cadre les métiers, la tech, la data, les RH et la direction générale, l’organisation recrée une chaîne de sens. Les cas d’usage cessent d’être de simples “projets IA” pour devenir les maillons d’une trajectoire de transformation. La feuille de route, jusque-là abstraite, se transforme en boussole partagée : chaque initiative trouve sa place, chaque investissement son horizon.
Ensuite, cette table rend possible l’arbitrage stratégique.
Car prioriser, c’est trancher ;et trancher ensemble. L’entreprise ne peut plus se contenter d’accumuler des projets séduisants : elle doit les évaluer selon des critères alignés sur sa stratégie. D’où la nécessité de construire des matrices communes, des KPI personnalisés, des critères de bénéfice et de complexité adaptés à sa réalité. La table devient alors un espace d’arbitrage collectif où la valeur se mesure autant en impact business qu’en cohérence organisationnelle. C’est là que naît la maturité : quand la technologie cesse d’être un objet d’expérimentation pour devenir un instrument de pilotage.
Mais plus profondément encore, une table bien structurée favorise la transformation culturelle.
Autour d’elle, les frontières s’effacent : les métiers comprennent mieux les contraintes techniques, la DSI découvre les leviers de la performance opérationnelle, les RH traduisent les enjeux humains du changement. L’IA devient un langage commun, un prétexte pour renouer avec une transversalité souvent perdue. C’est là tout le paradoxe de cette révolution : sous ses airs technologiques, elle réhabilite un besoin profondément humain ; celui de dialoguer pour comprendre avant d’agir.
Enfin, cette table redonne une vision systémique de la performance.
Elle ne cherche plus seulement des gains ponctuels, mais la cohérence d’ensemble : entre les données, les processus, les compétences et la stratégie. Elle fait émerger un principe de continuité, là où l’innovation crée souvent la discontinuité. En cela, elle agit comme un correctif au “syndrome du patchwork technologique” qui guette tant d’organisations : celui où chaque projet IA s’empile sans jamais composer un tout. À l’inverse, une gouvernance de la table permet de construire une trajectoire cumulative, où chaque avancée alimente la suivante.
Cette table de l’IA, quand elle fonctionne, n’est plus un lieu de réunion : c’est un lieu de respiration collective.
Un espace où la complexité est apprivoisée, où la vitesse technologique trouve un rythme stratégique, et où l’innovation se pense comme un effort concerté plutôt qu’une course solitaire.
C’est là que se joue la véritable transformation : non pas dans la sophistication des modèles, mais dans la qualité du dialogue. Et c’est peut-être là la leçon la plus précieuse de cette révolution : dans un monde où les machines apprennent à converser, les organisations doivent, elles aussi, réapprendre à parler ensemble.
Découvrez les retours d’expérience des dirigeants sur ce sujet lors de notre matinale de l’IA du 14 octobre