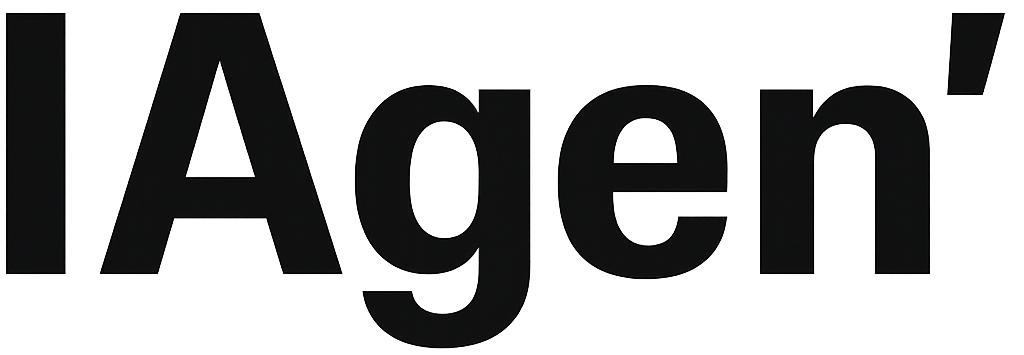Le caractère « science dure » que confèrent les textes de loi au juridique permet à l’intelligence artificielle de démontrer son efficacité, de même qu’avec les données chiffrées. Le gain de productivité est appréciable et le secteur particulièrement en pointe sur le déploiement de l’IA.
Mais cette implantation, précocement efficace en regard de nombreux autres métiers, cache-t-elle une transformation d’autant plus importante des pratiques, des métiers eux-mêmes ? Ou encore du rapport au droit de chaque citoyen, qui gagnerait en autonomie ? On ne peut pour le moment que se rassurer de voir le sujet pris à cœur par les professions juridiques, et depuis quelques années déjà.

Sur le terrain, le privé a une longueur d’avance
Précision, exhaustivité, rapidité… le droit plaide pour l’IA
Dès le lancement de ChatGPT 4, ce fut un des arguments commerciaux d’OpenAI : le Chatbot avait réussi l’examen du barreau américain et se plaçait dans les 10 % de tête. De quoi mettre en confiance la profession.
D’après une étude réalisée par Lefebvre-Dalloz, l’IA est utilisée par 76 % des directions juridiques et 68 % des cabinets d’avocat, c’est deux fois plus que la moyenne des entreprises. Le secteur a effectivement bénéficié très rapidement de solutions dédiées qui évitaient les approximations des outils généralistes, avec des résultats très concrets :
- Le travail de recherche et de compilation de données juridiques (lois, jurisprudence…) est devenu aussi rapide que fiable et quasi exhaustif.
- Une IAG peut produire des clauses contractuelles, des mémoires, des synthèses de décisions judiciaires, des résumés de contrats… 83 % des directeurs juridiques la préfèrent pour cette dernière tâche en particulier.
- L’IA peut fournir des analyses prédictives très performantes grâce à sa capacité à croiser des milliers de décisions juridiques passées, et procure aux avocats des arguments stratégiques de poids.
- …
Trois exemples qui parlent aux néophytes, mais la liste des services rendus est bien plus fournie : les tâches standardisées du juridique peuvent représenter plus de 40 % du temps de travail, pour des humains.
Néanmoins, l’absence de réelle compréhension d’une IA l’empêche dans le juridique comme dans tous les domaines de proposer une fiabilité parfaite. Le travail doit donc toujours être vérifié, par un juriste expérimenté de surcroît. Mais l’intégration de l’IA peut poser problème quant à l’acquisition de cette expérience (voir 3e partie).
L’IAG comme levier de diversification
On a déjà vu nombre d’entreprises commercialiser un outil (numérique ou pas) qui avait à l’origine été développé pour leurs propres besoins (Slack, Shopify, AWS, Dassault Systèmes…). Avec l’IA le phénomène s’observe donc sans surprise chez les juristes.
Le cabinet d’avocats A&O Shearman (environ 4 000 avocats) vient de dévoiler un outil qui va au-delà de ce qui se pratique avec l’IAG, et propose d’accélérer non pas le travail standardisé, mais celui des juristes seniors. L’objectif : gagner du temps, réduire les coûts… Mais aussi générer de nouveaux revenus en vendant l’outil à leurs confrères.
Le cabinet assure qu’il n’est pas prévu de supprimer des emplois, mais de libérer du temps pour que les avocats puissent se concentrer sur des tâches plus stratégiques.
À suivre…
Pour les institutions, un accélérateur de justice
La lenteur de la justice est sans doute le premier reproche qu’on est tenté de lui faire. Et on voit mal comment l’encombrement des tribunaux pourrait tendre à la réduction puisque l’empilement législatif est une sorte de fatalité de la complexification de notre société. L’IA est en train d’y contribuer.
Le tribunal de commerce de Paris teste actuellement l’IA en la dédiant aux procédures simples et récurrentes : 180 juges traitent actuellement deux fois plus de dossiers que la moyenne nationale. À terme, on ambitionne de réduire par 6 le temps utilisé pour préparer les procédures, permettant ainsi aux juges et greffiers de se consacrer davantage à des tâches plus complexes.
Ce gain d’efficacité devrait également profiter aux actions en justice lourdes mais qui « rapportent peu », comme certaines « class actions » et leur volume de données himalayesques, une sorte d’équivalent des maladies orphelines. Le principe s’applique de même aux avocats.
Des déploiements multiples, avec vigilance
Si la perspective de voir le temps judiciaire possiblement réduit est enthousiasmante pour l’ensemble du système, la sensibilité des données utilisées implique un niveau de précaution au plus haut. Une charte d’usage de l’intelligence artificielle est donc en cours d’élaboration par le ministère de la Justice. Parmi les sujets de sécurisation, celui de l’hébergement des solutions sur le territoire national est une priorité du ministère, pour garantir le respect des réglementations en vigueur et à venir.
Il est grand temps si l’on en juge par le nombre d’initiatives qui se développent, depuis l’expérimentation par le parquet de Paris du logiciel Albert (développé par la direction interministérielle du numérique) jusqu’aux accords des barreaux de Paris, et plus récemment de Lyon, avec la plateforme Doctrine.
On peut se rassurer tout de même en constatant que les institutions judiciaires se penchent sur le sujet depuis 2016, comme la cour de cassation qui a mis au point une IA pour « pseudonymiser » les décisions judiciaires disponibles en open-source, ou encore (et dès 2020) pour orienter les affaires vers les chambres civiles concernées, selon les près de 200 codes qui couvrent le spectre des contentieux.

La profession s’auto-surveille
Le Conseil National des Barreaux sur le sujet depuis longtemps
L’IA soulevant de nombreux défis juridiques (droit d’auteur, protection des données, usurpation…), les métiers du droit sont sensibles au sujet depuis quelques années déjà.
En 2019, Le Conseil National des Barreaux (CNB) constituait ainsi un groupe de travail avec pour résultat l’adoption d’une charte imposant le respect des principes de transparence, d’impartialité, et des droits fondamentaux dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. Le CNB avait également participé en 2020 au livre blanc de la Commission européenne sur l’Intelligence artificielle.
Avec l’avènement plus récent de l’IAG, et ses promesses de gains de productivité, le CNB s’est donné pour mission une feuille de route pour que les avocats s’emparent de l’IA, tout en éclairant un certain nombre de points de vigilance : droits et libertés fondamentales, exercice non autorisé du droit, règles et usages de la profession, formation…
L’enthousiasme n’empêche pas la vigilance
En septembre dernier, le CNB a publié un guide pratique au service des avocats proposant des façons d’y avoir recours dans la pratique professionnelle compatibles avec la déontologie, et alertant sur le fait que « l’IA n’est ni un moteur de recherche, ni une encyclopédie ».
Sans dénigrer les bénéfices de l’outil, le guide met en garde sur la génération de textes ou de synthèses parfaitement vraisemblables mais fausses, rendus dangereusement pertinents par le caractère assertif de ce qui est rédigé, et par la ressemblance avec ce qui se pratique : là est le principe même de l’IA. Et parmi moult recommandations, la trentaine de pages rappelle aux avocats que nombre des informations avec lesquelles ils travaillent sont couvertes par le secret professionnel, et qu’une IA généraliste est une sorte de place publique.
L’ajustement permanent
Menée par un institut de sondage à la demande du CNB, une vaste enquête est réalisée au printemps 2025 pour cartographier les utilisations et mieux identifier les besoins, des avocats comme de leurs clients. L’enquête se tourne également vers les non-utilisateurs de l’IA, dans l’idée de les accompagner et de réduire les éventuelles difficultés à son adoption.
Même positionnement côté magistrature
Forte de son expérience sur le sujet IA, la Cour de cassation a dernièrement proposé une méthodologie d’implémentation. Très enthousiaste sur le potentiel gain de productivité grâce à l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée, la cour voit non seulement le moyen de rendre plus de justice, mais aussi « d’enrichir le débat juridique et le dialogue des juges », grâce à une meilleure rationalisation du traitement des contentieux. Par ailleurs, le rapport rappelle qu’il ne suffira pas de respecter le RGPD ou le RIA (Règlement européen sur l’IA, IA Act en anglais) pour un usage vertueux « qui préserve la plénitude de l’office du juge et ne vienne pas amoindrir ou fragiliser les équilibres fondamentaux du procès équitable ». Il convient de prendre en considération l’impact sur la fonction de juger, qui repose sur des faits, des lois, et une intime conviction profondément humaine qui se construit sur leur observation.
Lire la newsletter « L’IA pour le sens critique : de l’assistance à la prothèse. »
Le chiffre : 44 %
C’est selon Lefebvre-Dalloz la proportion des tâches juridiques qui pourraient être automatisées.

Vigilance sur la formation
La formation initiale forme surtout à l’humanité
L’enthousiasme n’est pas généralisé chez les professeurs de droit.
En premier lieu, et comme dans tous les apprentissages, l’IA pose des défis pour l’évaluation : la tricherie, le plagiat, le recours à ChatGPT… si on peut aussi positiver parce que cela peut développer la créativité des étudiants, encore faut-il qu’ils aient un regard suffisamment critique sur l’IA.
On loue en revanche la capacité qu’offre l’IA de développer des suivis individualisés à grande échelle, et son adéquation avec les modes d’apprentissage des jeunes générations. Mais si le droit comporte sa part de science dure avec les textes de lois, cette part du savoir n’est appréhendable que par le prisme des compétences humaines : tactiques, stratégiques, humanistes, sociales… Des compétences dont l’IA est forcément éloignée, et qui s’acquièrent par la transmission d’un professeur, par le débat collectif et les interactions humaines.
« L’Université n’est pas là pour fabriquer des perroquets, mais pour rendre autonome. »
Jean-Emmanuel Ray, Professeur émérite de droit privé – Paris I Sorbonne
Si l’IA peut provoquer un nivellement par le haut du métier en éliminant certaines fonctions basiques, c’est parce que le côté humain du droit aura été valorisé pour forger l’expertise. Comme dans toute discipline.
Apprentissage : les « fourmis » du juridique en danger ?
Entendez le travail de fourmi, standardisé et mécanique. Celui qui consiste à rechercher les textes de lois, les jurisprudences… Ce en quoi l’IAG excelle. La tâche fastidieuse est traditionnellement confiée aux stagiaires, aux jeunes recrues, qui renforcent ainsi leur formation initiale, et profitent de l’expérience des seniors qui travailleront ensuite « la matière » qu’ils proposent.
Dans cette exécution, l’IAG se montre plutôt plus précise que l’humain, avec une rapidité évidemment incomparable. La tendance serait dorénavant de former les juniors aux prompts, avec un problème qui se pose : il faut de l’expérience pour analyser (et éventuellement corriger) ce que propose la machine dans ses synthèses. Expérience qui s’acquiert entre autres avec le travail de fourmi…
Un sujet à surveiller pour la profession si elle veut garantir sa relève, et le phénomène se rencontre dans la plupart des activités.
Lire la newsletter « IA et social : Entre crainte de la casse et opportunités »
Formation continue, ne laisser personne sur le banc… des avocats
Chacun des deux est hégémonique dans son domaine de compétence, ce qui confère à l’initiative du CNB et de Lefebvre-Dalloz une envergure à la hauteur du sujet. Une bonne chose puisque le parcours de formation à l’intelligence artificielle qu’ils proposent s’adresse à l’ensemble de 78 000 avocats et 6000 élèves avocats de France.
Dispositif gratuit et 100 % digital, cet accompagnement de la transformation du métier d’avocat sera disponible sur une plateforme de e-learning dédiée, Skilia Avocats, jusqu’à la fin de 2027. La volonté est d’éviter à tout prix que s’installe une fracture numérique entre les professionnels.
Si une campagne d’une telle ampleur n’est pas encore annoncée pour les magistrats, la fonction n’est pas en reste en termes de formation, initiale ou continue.
Alors qu’à l’échelle macrosociale on observe davantage d’inquiétudes que d’enthousiasme, le juridique positive plus que la moyenne des secteurs d’activité. Sans doute le fait d’une anticipation qui n’a pas attendu le buzz ChatGPT, et d’une préparation méthodique qui ouvre un horizon avec plus de justice, plus rapide, et pour plus de bénéficiaires.
À imiter sans doute.
Sans oublier le regard circonspect.