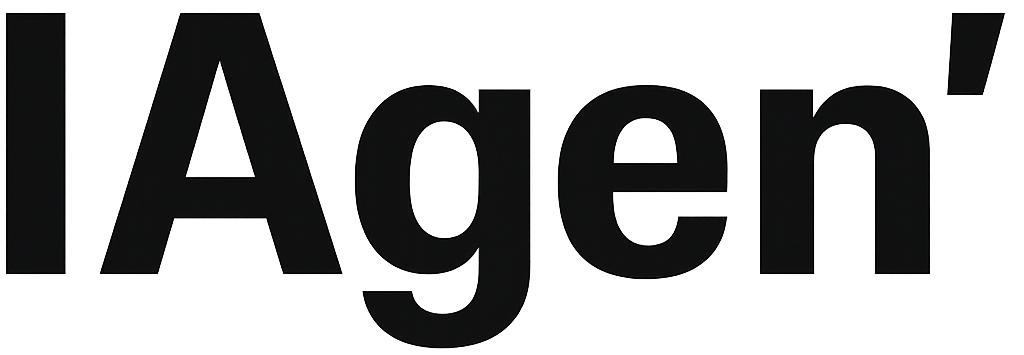Si l’IA générative bouscule plus que les autres ruptures technologiques auxquelles, finalement, nos sociétés sont habituées, c’est parce qu’elle peut suppléer à ce dont l’humain est sans doute le plus fier dans son statut biologique d’animal, et qui fait son humanité : la créativité. Cette capacité à générer soulève de nombreux problèmes, depuis son fonctionnement, qui utilise le travail créatif soumis au droit d’auteur pour s’entraîner, jusqu’à son utilisation, dont on peut légitimement craindre qu’elle nuise à la créativité.

Créateurs de tous les pays, unissez-vous !
C’est le propre d’Internet que d’être global. L’IA qui en est une quintessence épouse totalement ce principe, contre elle, en générant une levée de bouclier mondiale pour défendre le droit d’auteur. Des USA à l’UE en passant par le Royaume-Uni, et malgré des cultures très différentes en matière de media business ou de politiques culturelles, on a observé des réactions similaires des ayants droit, des créateurs, pour lutter contre la mise en place d’une « kleptocratie » du contenu. En cause, l’opacité totale des grands opérateurs sur les contenus qui servent à entraîner leurs LLM, et donc l’absence de rémunération.
Une envie de FAIR
Quelques mois seulement après la sortie grand public de ChatGPT, Hollywood connaissait la plus importante grève de son histoire, 118 jours, mené par les scénaristes et les comédiens. L’automne dernier, ce sont 13 500 artistes qui ont signés une nouvelle pétition. Côté presse, c’est le New York Time qui a ouvert le bal fin 2023 en attaquant Open AI, d’autres grands titres ont rejoint la piste.
Au Royaume-Uni, après des propositions du gouvernement qui pourraient affaiblir la protection du droit d’auteur face aux IA, la campagne « MAKE IT FAIR » multiplie les unes de journaux, puisque soutenue en premier lieu par la presse, et pointe que l’absence de contrôle et de rémunération menace l’industrie créative britannique, valorisée à 152 milliards de dollars. Et pour illustrer métaphoriquement cette menace, 1000 artistes ont co-signé un album de 12 chansons… silencieuses.
La France porte drapeau ?
C’est donc très logiquement que le sujet se soit invité au sommet de l’IA de Paris en février dernier, avec des tensions puisque les autorités ont à cœur de protéger leurs champions nationaux (Mistral n’est pas plus vertueux pour le moment). L’association « France Digitale » a émis une proposition pacificatrice, avec une « licence légale » inspirée de la copie privée qui permettrait d’éviter des négociations complexes (développement en 2° partie).
« Le monde entier regarde ce que la France va faire en termes de régulation. Nous avons valeur d’exemple… » déclare Cécile Rap-Veber, directrice de la Sacem, leader mondial de la gestion du droit d’auteur (fondée en 1851). Elle n’est pas forcément la plus objective, mais rappelons au passage que le droit d’auteur est une invention française (Beaumarchais, 1791).
L’hexagone accuse un certain retard dans le leadership technique de l’IA, mais celui de la régulation n’est pas des moindres : le bon usage et la confiance sont aussi des garanties de performance.

Comment être transparent tout en gardant son secret ?
L’IA générative puise sa « créativité » dans les créations des autres, il ne saurait en être autrement, et la créativité humaine a d’ailleurs toujours procédé ainsi. Qu’elle soit artistique, scientifique, philosophique… l’inspiration naît en grande partie des travaux de ses prédécesseurs. Entre humains, le fait est surveillé, régulé, légiféré, ce qui n’empêche pas les tricheries, les omissions et les procès.
La difficulté du sujet de l’entraînement des LLM c’est qu’il constitue une sorte de mise en abyme : si un opérateur est totalement transparent sur les sources qui constituent son corpus, afin d’en rémunérer les auteurs, il dévoile une partie de son secret de fabrication, qu’il est tout à fait en droit de protéger au titre de la propriété intellectuelle.
Quand on ne peut pas savoir, on fait au hasard.
Le problème s’est posé sous une autre forme il y a plus de 60 ans avec l’apparition de la cassette audio en 1963, qui permettait au grand public de profiter d’une œuvre sans l’avoir forcément achetée. Deux ans plus tard, pour mettre fin à un litige, l’Allemagne mettait en place un prélèvement sur les ventes de cassettes et d’enregistreurs, reversé aux artistes, producteurs… La France, pas championne à l’époque, ne l’a fait que 20 ans plus tard.
La « copie privée » s’est étendue à de nombreux pays et à tous les supports : CD, DVD, clef USB, smartphones et les prochains sur la liste devraient être les data centers.
C’est ce principe globalisé qui inspire la proposition de France Digitale de « licence légale » : tout le monde contribue et on redistribue à tout le monde. Chercher à vérifier dans le détail impliquant non seulement de révéler un secret industriel, mais aussi une complexité sans doute insurmontable.
Autre axe de régulation, celui proposé par Fairly Trained : labéliser des modèles d’IA génératives qui s’engagerait à n’utiliser aucune œuvre protégée par le droit d’auteur sans en avoir l’autorisation. Un principe plus accessible pour des modèle spécialisés, musique, image, sciences, mais là encore, peut-être trop complexe pour les généralistes.
Et comme gendarme, l’IA ?
Cette très grande difficulté à organiser et surveiller la protection de la propriété intellectuelle contre l’IA pourrait bien trouver sa solution… dans l’IA elle-même.
Les agentic workflows, des IA capables d’autonomie et d’interactions entre elles sont une convergence de technologies : IA, blockchain/NFT et big data. Ces dispositifs auraient en effet la capacité d’assurer la surveillance en temps réel du web, de détecter les violations de droits, à une échelle inégalée.
Quand le problème et la solution ne font qu’un.
Le chiffre : 1969
C’est l’année où la pionnière de l’art numérique Vera Molnar (1924-2023) a pour la première fois utilisé un ordinateur pour générer une œuvre.

Pour la créativité, un stimulant ou une béquille ?
Celle liée à l’IA s’est donné rendez-vous chez Christie’s, jusqu’au 5 mars et en ligne, pour une vente aux enchères de 34 œuvres exclusivement générées par intelligence artificielle : évènement intitulé « Augmented Intelligence », avec entre autres des œuvres de Refik Anadol, sommité du domaine dont les créations peuvent s’envoler jusqu’à 2 millions de dollars. L’initiative n’a pas fait l’unanimité, et une pétition forte de 6000 signatures a tenté de l’empêcher en dénonçant un « vol massif de travaux d’artistes humains ».
À quoi ressemble une œuvre générée par IA ? Ce peut être une sorte de magma coloré en mouvement donnant l’impression de profondeur sur 2,7 m de hauteur, ou une IA qui esquisse un visage et s’arrête quand l’IA d’en face le comprend, puis recommence. L’éventail créatif semble sans limite…
L’événement a surtout été l’occasion de se rendre compte que l’art numérique ne date pas d’hier, en présentant des œuvres de 1966. Caractère « historique » qu’a confirmé la salle de ventes Drouot en proposant des œuvres de Vera Molnar « grand-mère de l’art génératif », qui a conceptualisé en 1959 sa « machine imaginaire », avant même l’apparition des ordinateurs.
La créativité IA révélatrice de nos stéréotypes
C’est parmi d’autres le constat qui se dégage d’une exposition bruxelloise de photos générées par IA, qui propose une réflexion sur la mémoire, l’archive et le stéréotype. Un exemple : la revisite par l’IA d’une célèbre photo d’Annie Leibovitz où John Lennon, nu, enlace Yoko Ono habillée. La reproduction IA a inversé les rôles, c’est Yoko qui est nue, parce qu’il existe infiniment moins de nus masculins dans l’histoire de la photographie.
Jordan Beal, artiste originaire de la Martinique, a fait travailler une IA à la génération d’images de son île : des couleurs sucrées et des thèmes révélant un héritage visuel qui écarte le réel. « Je vis là où on part en vacances », s’amuse l’artiste.
L’IA stimulant ou béquille ?
Les artistes se sont toujours emparés des techniques et technologies dès leur apparition. La nouveauté numérique a permis de s’affranchir de la maîtrise technique originelle : on peut créer de la musique sans pratiquer un instrument ou connaître le solfège, créer des images sans tenir un crayon… Avec tout de même le besoin de maîtriser ces outils de substitution.
Est-ce un bien, ou un mal ?
David Guetta est-il un musicien ou pas ?
En matière artistique, la subjectivité est trop grande pour juger du bienfondé d’avoir des outils qui remplacent ce qui est normalement le fruit d’un apprentissage spécifique, instrument, pinceau… On pourra faire aussi l’analogie avec le clavier, plus facile à maîtriser que l’écriture manuscrite : « azerty » n’a pas particulièrement nui à la création littéraire.
L’IA change la donne en proposant de générer des idées, qui précèdent leur réalisation par l’outil. Il est trop tôt pour porter un jugement sur les conséquences créatives en matière artistique, et il restera toujours subjectif.
Mais un parallèle est possible avec des effets plus objectifs qui ont été étudiés.
L’IA altère la pensée critique
Microsoft et l’université Carnegie Mellon ont mené une étude à laquelle ont participé 319 travailleurs des domaines de l’informatique, des mathématiques, des arts et du design. Elle a mis en lumière un phénomène qui ne rassure pas : l’utilisation de l’IA semble réduire la pensée critique. Rien d’étonnant non plus puisque l’on confie à une IA le travail d’analyse qui construit la pensée critique… On ne se muscle pas les cuisses sur une trottinette électrique.
Le phénomène s’observe davantage sur des personnes peu expérimentées, qui remettent moins en question les propositions de l’IA que les utilisateurs qui ont une plus grande confiance dans leur propre savoir.
On a connu récemment le fait de se décharger d’informations, comme les numéros de téléphones que l’on connaissait par cœur, les itinéraires… À cause des smartphones, de Google Maps. Il est impossible de mesurer à quel point nous avons globalement externalisé nos connaissances, puisqu’elles sont toutes accessibles d’un clic, et à quel point c’est dommageable.
Mais avec une utilisation non raisonnée de l’IA, ce n’est pas de l’information mais de la réflexion dont nous nous déchargeons, explique Michael Gerlich, chercheur en intelligence artificielle. Sa recommandation est d’utiliser l’IA pour challenger les hypothèses et éviter les biais de confirmation. Un stimulant et non pas une béquille.
Le sens critique, c’est le guide de la prise de décision.
La créativité, c’est une suite de prises de décision.
L’IA est comme tous les outils. Quand on ne sait pas s’en servir, on fait des dégâts… À hauteur de la puissance de l’outil.
Lire la newsletter «L’IA pour le sens critique : De l’assistance à la prothèse.»