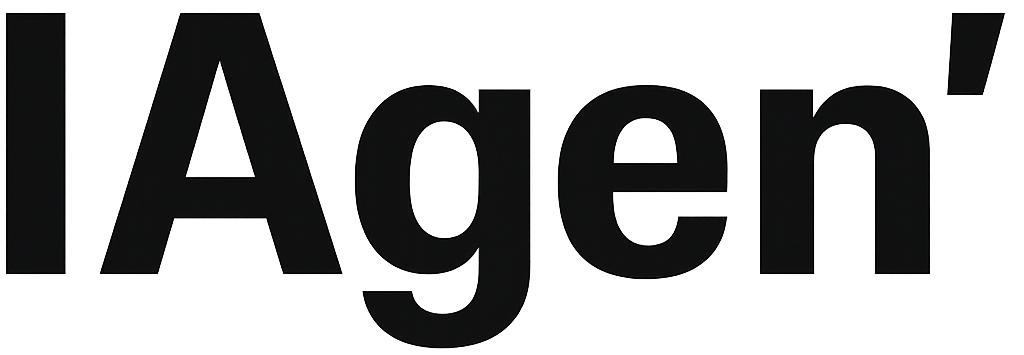L’IA n’attend pas : un tournant comparable à l’électricité
Quand l’électricité s’est diffusée au tournant du XXe siècle, elle n’a pas seulement remplacé la vapeur ou l’énergie animale : elle a redéfini la manière de produire, d’organiser les usines et même de concevoir les villes. Ce n’était pas une innovation parmi d’autres, mais une infrastructure fondatrice qui allait soutenir toute l’économie industrielle. Ceux qui s’en sont tenus à des usages marginaux – par exemple, remplacer une lampe à huile par une ampoule – ont vite été dépassés par ceux qui ont réinventé leur modèle de production autour de cette nouvelle énergie.
L’intelligence artificielle se situe exactement dans cette dynamique. Elle n’est pas un simple outil ou une fonctionnalité additionnelle : elle est en train de devenir l’énergie cognitive de l’économie. Là où Internet avait mis une décennie pour transformer les usages, l’IA générative s’est imposée en deux ans à peine auprès de centaines de millions d’utilisateurs. Et cette adoption fulgurante ne touche pas seulement le digital : elle traverse la finance, la santé, la logistique, la relation client, la création de contenus. Aucune fonction de l’entreprise n’y échappe.
Or, c’est précisément ici que réside l’écart stratégique entre deux approches. La première – le modèle “+AI” – consiste à ajouter des briques d’IA sur un existant : un chatbot pour le support, un moteur de recommandation pour l’e-commerce, quelques automatisations RH. Utile, certes, mais superficiel. La seconde – le modèle “AI+” – prend l’IA comme moteur fondateur du modèle de valeur. Elle n’est pas un supplément mais une matrice : elle structure la collecte et l’usage des données, l’architecture technologique, les processus métiers et, in fine, la proposition faite au client.
C’est exactement ce qui s’est joué à l’ère de l’électricité. Les entreprises qui se sont contentées de remplacer la vapeur par un moteur électrique ont progressé un temps. Mais celles qui ont repensé l’organisation complète de leurs usines autour de la flexibilité et de la productivité offertes par l’électricité ont pris une avance décisive dans le temps long. Aujourd’hui, la même fracture se dessine : les acteurs “+AI” gagneront en efficacité marginale, mais les acteurs “AI+” redéfiniront les règles du jeu à l’avenir.
La question n’est donc pas de savoir si l’IA va s’imposer – ce point est acquis. La vraie question est de savoir qui saura en faire une énergie transformatrice, et qui restera à la surface, dans des usages cosmétiques. Car le retard ne se mesure pas en mois de projet, mais en générations de compétitivité. Les cycles d’innovation se contractent à une vitesse inédite : là où l’on disait qu’une “année technologique” comptait pour sept années humaines, à l’image des “années de chien”, l’IA générative et les agents évoluent désormais à la cadence des “années de souris”, où une seule année en équivaut à trente. Dans un tel contexte, ne pas anticiper revient à être dépassé non pas dans quelques exercices budgétaires, mais dans l’équivalent d’une vie entière de compétitivité.
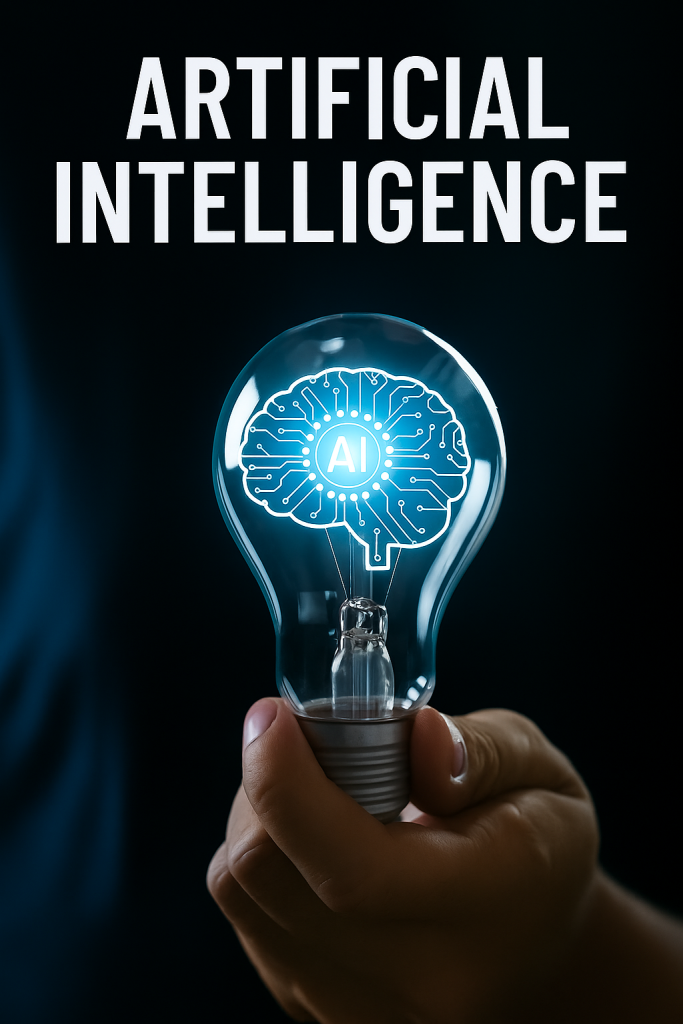
Une échelle de maturité en 5 niveaux
L’intégration de l’IA dans l’entreprise n’est pas un processus binaire entre “avoir de l’IA” ou “ne pas en avoir”. C’est une trajectoire progressive, jalonnée d’étapes distinctes qui permettent de mesurer le chemin parcouru et d’anticiper la marche suivante.
Cette progression peut se lire en cinq niveaux de maturité :
- Exploration émergente et acculturation
Les entreprises découvrent les capacités de l’IA, testent des outils grand public (copilotes bureautiques, assistants conversationnels) et sensibilisent leurs équipes. L’enjeu n’est pas encore la performance, mais l’apprentissage collectif et la levée des résistances culturelles. - Expérimentations dispersées
Les POC se multiplient dans différents départements (RH, marketing, finance) mais sans cohérence d’ensemble. Les gains existent, mais restent fragmentés et souvent difficiles à mesurer. Le risque est de s’enfermer dans une inflation de tests sans vision directrice. - Structuration ciblée
À ce stade, l’organisation identifie et priorise les cas d’usage à fort impact. Elle commence à mettre en place des fondations communes : gouvernance des données, infrastructures partagées, règles de conformité. L’IA devient un sujet transversal, même si son adoption reste concentrée sur quelques métiers stratégiques. - Intégrations transverses
L’IA irrigue désormais plusieurs fonctions via une plateforme mutualisée. Les données sont consolidées, les outils interopérables, les projets alignés sur une vision claire. L’effet de levier se fait sentir : les gains ne sont plus ponctuels mais cumulés à l’échelle de l’organisation. - Transformation systémique (AI+)
L’entreprise atteint le niveau le plus avancé : l’IA n’est plus une brique ajoutée, mais l’ossature du modèle. Les processus métiers sont repensés à partir de ses capacités, la gouvernance s’appuie sur des indicateurs précis de performance liés à son usage, et l’IA devient le moteur central de création de valeur.
Cette grille de lecture permet de sortir du mythe du “grand soir de l’IA” : aucune entreprise ne bascule du jour au lendemain dans un modèle centré sur l’intelligence artificielle. Ce qui distingue les acteurs en avance, c’est leur capacité à progresser par paliers, en consolidant chaque étape plutôt que de multiplier les expérimentations opportunistes.
De l’ajout d’IA au modèle AI+
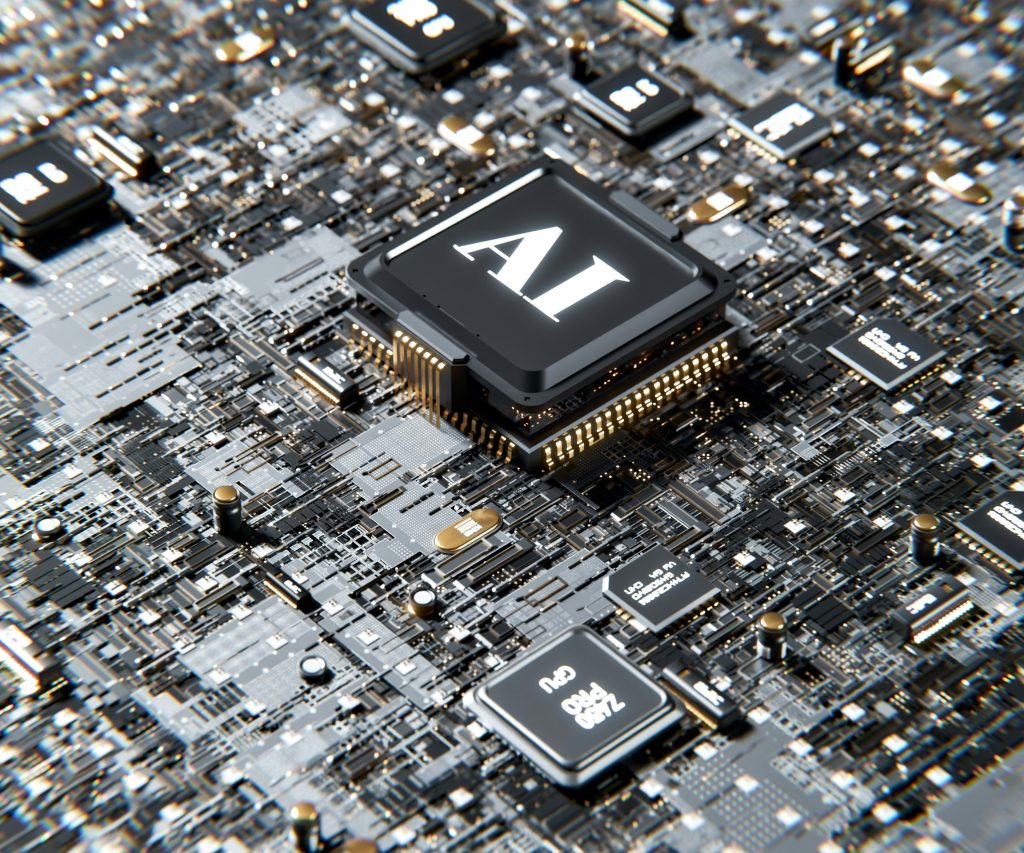
C’est à l’horizon du cinquième niveau que se joue la différence stratégique entre “+AI” et “AI+”. Aujourd’hui, la majorité des entreprises en sont encore à une approche superficielle. Elles ajoutent des briques d’IA à l’existant : un copilote intégré dans la suite bureautique, un chatbot pour le support client, un outil d’automatisation RH. Ces initiatives relèvent d’une logique “+AI” : l’IA est greffée sur les processus actuels, sans remise en cause de la gouvernance des données ni du modèle économique. Cela permet d’obtenir des gains rapides et visibles, mais rarement durables.
À l’inverse, une minorité d’acteurs avance déjà dans une logique “AI+” : l’IA n’est plus un accessoire, elle devient l’armature du modèle. Les chaînes de valeur, l’expérience client et la gestion opérationnelle sont conçues directement à partir de ses capacités. Les données ne sont plus segmentées par département, mais traitées comme un actif stratégique transversal. Les copilotes ne sont pas des gadgets isolés, mais des interfaces structurantes entre collaborateurs, systèmes et clients. Et la gouvernance ne se limite plus à additionner des projets, mais s’oriente vers une mesure continue de l’impact organisationnel.
Passer de “+AI” à “AI+” implique donc une discipline exigeante :
- clarifier les cas d’usage stratégiques et éviter les effets de mode
- construire des fondations technologiques communes et sécurisées
- intégrer l’IA dans la gouvernance au même titre que la finance ou les opérations
- acculturer massivement les équipes pour garantir l’adoption réelle
- planifier une montée en puissance progressive mais orientée vers la systématisation
En clair, l’IA n’est pas un plug-in. C’est une architecture de transformation. Celles qui s’en tiendront à un patchwork d’outils “+AI” verront leurs coûts croître sans avantage compétitif durable. Celles qui basculeront vers un modèle “AI+” poseront les bases d’une agilité organisationnelle, d’une exploitation cohérente des données et d’une différenciation forte sur leurs marchés.
Entreprises établies vs pure players IA : deux chemins, un même enjeu
L’adoption de l’IA n’oppose pas seulement les entreprises avancées et les retardataires ; elle met en lumière un contraste structurel entre les pure players nés “IA-native” et les entreprises établies. Trois lignes de fracture apparaissent.
Agilité vs inertie
Les pure players bâtissent leurs architectures technologiques directement autour de l’IA, sans systèmes hérités ni couches de complexité accumulées. Ils peuvent tester, lancer et industrialiser rapidement de nouvelles solutions. À l’inverse, les entreprises historiques doivent composer avec une inertie organisationnelle : dette technologique, silos internes, lourdeurs de gouvernance. Chaque expérimentation IA se heurte à des couches de systèmes existants qu’il faut connecter ou remplacer.
Dette technique vs data historique
Là où les nouveaux entrants jouissent d’une liberté architecturale, ils partent de zéro en matière de données. Les acteurs établis disposent, eux, de volumes considérables de données transactionnelles, clients ou opérationnelles, accumulées sur des décennies. Bien exploité, cet héritage représente un avantage décisif pour entraîner des modèles pertinents et différenciés. Mal géré, il devient une dette supplémentaire : données dispersées, qualité hétérogène, gouvernance insuffisante.
Conquête vs confiance
Les pure players avancent à vive allure dans la conquête de parts de marché, mais doivent bâtir leur crédibilité de toutes pièces. Les entreprises établies, elles, bénéficient de la force de leur marque et de la confiance des clients, notamment dans les secteurs régulés où la réputation est un actif stratégique. Encore faut-il transformer cette confiance en levier pour déployer des IA qui augmentent réellement la valeur perçue par les clients.
En définitive, la fracture n’est pas tant entre anciens et modernes qu’entre ceux qui savent transformer leur héritage en atout, et ceux qui le subissent comme un frein. La question devient alors inévitable : qui fera de son passé un tremplin, et qui restera prisonnier de son propre fardeau ?
Lift, Shift, Rift ou Cliff : quatre trajectoires possibles

Face à l’IA, aucune entreprise ne peut rester sur place. Le statu quo n’existe pas : chaque organisation est déjà engagée, qu’elle le veuille ou non, sur une trajectoire étroitement liée à sa maturité sur les sujets IA. Celle-ci peut mener à l’élévation (Lift), à l’adaptation (Shift), à la fracture (Rift) ou à la chute (Cliff).
Lift : l’IA comme levier de croissance
Certaines entreprises parviennent à transformer l’IA en moteur stratégique. Elles réinventent leurs modèles économiques, gagnent en productivité, et ouvrent de nouveaux marchés. Pour elles, l’IA est un ascenseur de compétitivité : chaque cas d’usage consolidé nourrit une dynamique cumulative.
Shift : l’IA comme discipline de transformation
Pour la majorité des organisations – en particulier celles qui portent un fort héritage technologique – l’enjeu n’est pas d’innover à tout prix, mais d’avancer avec méthode. Atteindre au minimum le niveau 3 de maturité IA (structuration ciblée) devient une condition de survie. En deçà, les initiatives restent dispersées, l’alignement stratégique absent, et le risque de dérapage vers le Cliff s’accroît. Le Shift n’est donc pas un luxe, mais le passage obligé pour transformer un legacy en avantage compétitif.
Rift : la fracture organisationnelle
À défaut de vision claire, certaines entreprises laissent l’IA s’installer par à-coups, sans gouvernance ni cohérence. Les directions métiers expérimentent dans leur coin, la DSI peine à suivre, et la fragmentation s’installe. Le résultat : un empilement d’outils, une dette technique aggravée, et des tensions internes qui creusent un écart de compétitivité durable.
Cliff : la chute
C’est la trajectoire de ceux qui n’agissent pas, ou trop tard. Les coûts restent élevés, les marges se contractent, les talents partent vers des entreprises plus innovantes. Dans des marchés où de nouveaux entrants peuvent s’imposer en quelques années, la chute est brutale. Pour les entreprises avec un fort legacy, rester bloquées aux niveaux 1 ou 2 de maturité IA n’est rien d’autre qu’une marche vers le précipice.
En résumé, le Lift est l’horizon souhaité, le Shift la discipline indispensable, le Rift une fracture coûteuse, et le Cliff la menace existentielle.
Pour les entreprises héritières d’un legacy lourd, la règle est claire : atteindre rapidement le niveau 3 de maturité IA dans une trajectoire dite Shift, ou accepter le risque de disparaître.
Conclusion :
L’intelligence artificielle n’est plus un simple outil : elle devient l’énergie cognitive de l’économie. Comme l’électricité au XXe siècle, elle redéfinit les modèles de production, la gestion des organisations et la valeur créée pour le client. Les entreprises qui se contenteront de superposer des briques d’IA sur leur modèle existant gagneront en efficacité marginale, mais risquent de rester à la surface à l’avenir. Celles qui intègrent l’IA comme ossature de leur modèle, planifiant leur trajectoire vers l’AI+, transformeront radicalement leurs processus, leurs données et leur proposition de valeur.
Le choix est clair : rester sur le quai et subir le Cliff, ou embarquer dans le train de la compétitivité, passer par le Shift et viser le Lift. L’IA ne fait pas de cadeau, mais elle offre un levier de transformation inégalé à ceux qui sauront transformer leur héritage en atout stratégique.
Par ailleurs, la question du levier stratégique est au centre de notre prochaine Matinale de l’IA, le 14 octobre, dont le thème est : « Construire une Roadmap IA créatrice de valeur”.
À cette occasion, le Groupe Aurecis (Obea, Kanbios, Isskar, Com1pact) vous propose un moment unique pour découvrir des retours d’expérience de grandes organisations, participer à un atelier de co-construction en direct… et bien sûr échanger autour d’un petit-déjeuner convivial.
Une opportunité idéale pour repartir avec des clés concrètes et structurer votre propre trajectoire IA.
Inscrivez-vous via ce lien